17/06/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

par Jihene FREDJ
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie
Affaire : Cons. const., décision 2021-965 QPC du 28 janvier 2022, Société Novaxia e.a.
De premier abord, le marché financier peut sembler être le domaine le moins concerné par les violations des droits et des libertés fondamentaux. Cependant, cette décision du Conseil constitutionnel montre le contraire.
Un marché financier est, selon l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), un lieu physique ou virtuel, où les acteurs du marché (acheteurs, vendeurs) se rencontrent pour négocier des produits financiers. Il permet de financer l’économie, tout en permettant aux investisseurs de placer leur épargne. Dans un contexte de scandales boursiers français où des sociétés, comme la fameuse affaire Altran de 2002, tentent de gonfler artificiellement leurs chiffres d’affaires, le juge et le législateur se sont chargés de réprimer tout abus faussant les marchés financiers.
L’AMF (selon l’article L.621-1 du même code) est une autorité publique indépendante créée par la loi du 1er août 2003. Elle a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie dans les marchés d’instruments financiers et à leur bon fonctionnement. Cette autorité indépendante procède à des contrôles sur place et à des enquêtes et sa Commission des sanctions peut prononcer des sanctions à l’encontre des auteurs de manquements à la réglementation boursière.
En l’espèce, est en cause la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, qui répriment les obstacles aux fonctions des agents de l’AMF d’une sanction administrative pécuniaire. Ces mêmes faits constituent aussi un délit incriminé par l’article L. 642-2 du même code.
Il s’agit dans la présente affaire de la société Novaxia développement et autres, une société de gestion de portefeuille, qui a fait l’objet d’un contrôle par les agents de l’Autorité des marchés financiers, qui ont demandé la communication de certaines informations. Elle refuse, ce qui donne lieu à des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF. A l’occasion du recours formé contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, la société soulève une QPC, qui est renvoyée au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation le 4 novembre 2021.
La QPC soulève la question de la conformité à la Constitution et en particulier à l’article 8 de la DDHC, des dispositions contestées, relatives à l’entrave à l’enquête ou au contrôle réalisés par les services de l’Autorité dans le cadre de sa mission de police administrative.
Le Conseil constitutionnel se penche sur deux moyens parmi les quatre soulevés par le requérant et écarte les deux autres rapidement. En l’espèce, la société alléguait que les manquements reprochés n’étaient pas définis de manière assez claire et étaient assortis d’une sanction « manifestement excessive ». Le grief le plus important dans cette affaire est celui de la violation du principe de nécessité de délits et des peines en raison du possible cumul entre la sanction administrative prévue par les dispositions contestées et la sanction pénale visée à l’article L.642-2.
Le Conseil décide d’opérer son contrôle sous l’angle du principe de nécessité et rend une décision de non-conformité partielle, prononçant l’inconstitutionnalité de la sanction administrative.
Ainsi, il commence par rappeler qu’une sanction pécuniaire peut avoir une nature répressive si elle revêt un caractère punitif selon l’article 8 DDHC, c’est-à-dire si celle-ci est manifestement élevée. Premièrement, sur la sanction administrative prévue, cette dernière est selon le juge constitutionnel une peine proportionnelle à la gravité des manquements réprimés et donc le législateur « a poursuivi l’objectif de préservation de l’ordre public économique » en s’assurant que le montant était assez dissuasif dans un but de prévenir les infractions et assurer l’efficacité des contrôles de l’AMF.
Deuxièmement, le Conseil s’attarde sur la question du cumul en rappelant tout d’abord son considérant de principe selon lequel une personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, et aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Il rappelle aussi que lorsqu’un cumul est admis, si ces conditions ne sont pas réunies, le montant global ne pourra dépasser la limite du maximum légal le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
En l’espèce, l’entrave aux enquêtes et contrôles de l’AMF est réprimée par deux sanctions, l’une pénale (article L. 642-2 CMF) prévoyant deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros ou de 1 500 000 euros s’agissant d’une personne morale conformément au Code pénal, l’autre administrative visée dans les dispositions contestées, dont le montant est fixé à 100 millions d’euros. Au regard de ces éléments, il ressort qu’un même fait peut faire l’objet d’un cumul de sanctions de même nature, à savoir pécuniaire, tout en ayant aussi un même objectif de protection de l’ordre public économique. Ce cumul est donc jugé contraire au principe de nécessité des peines et des délits.
Ce n’est pas la première fois qu’un article du Code monétaire et financier est abrogé au nom de la méconnaissance du principe de nécessité des peines dont découle la règle non bis in idem. En effet, d’autres dispositions de l’article contesté en l’espèce ont été censurées par deux décisions du 18 mars 2015, dans lesquelles le juge constitutionnel a posé les critères d’appréciation du jeu de la règle non bis in idem et le plafonnement au maximum de la sanction la plus élevée si le cumul est admis.
Pareillement, dans une décision QPC du 26 mars 2021, le juge constitutionnel a censuré le cumul de sanctions pénale et administrative concernant l’obstruction aux fonctions des agents de l’Autorité de la concurrence. Cette décision se rapproche du cas d’espèce puisqu’il s’agit du même type de comportement.
Cette décision QPC n’est donc pas nouvelle et s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constitutionnelle protectrice en cas d’abus de marché. Cette solution est aussi conforme à la jurisprudence des juges européens. En effet, la question du cumul des sanctions administrative et pénale pour un même fait, a fait l’objet d’un important contentieux au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’Homme ayant dans un premier temps exclu la possibilité de cumuler (arrêt Grande Stevens c. Italie), avant de l’admettre sous certaines conditions, en parlant de « prévisibilité » (arrêt A et B c. Norvège). La Cour de justice de l’Union européenne quant à elle, exige des « règles claires et précises ». Cette évolution du contentieux a ainsi poussé le Conseil constitutionnel au cours des dernières années à mieux cerner sa jurisprudence en la matière.
En effet, il s’agit d’un assouplissement du principe non bis in idem qui est un principe fondamental de la procédure pénale aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ». On encadre ainsi une entorse à ce principe dans le but d’assurer une répression effective des infractions de marchés.
Bien que cette décision censure la superposition de sanctions par le biais d’un raisonnement classique, celle-ci soulève tout de même des questionnements. Il est regrettable que le Conseil ait esquivé les autres griefs soulevés par le requérant, à savoir l’atteinte à la vie privée et le droit de ne pas s’auto-accuser, susceptibles d’être atteints dès lors qu’il y a obligation de remettre certains documents aux agents de contrôle de l’AMF, sous peine de sanction.
En somme, le Conseil constitutionnel n’innove pas en la matière et se cantonne à son rôle habituel de gardien du principe de la nécessité des peines et des délits.

Actualité
17/06/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur
16/06/2025
Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent
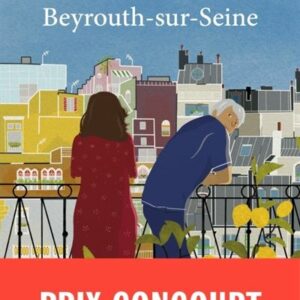
Coup de coeur
30/05/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur
28/05/2025
Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité
14/05/2025
Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité
07/05/2025
Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et
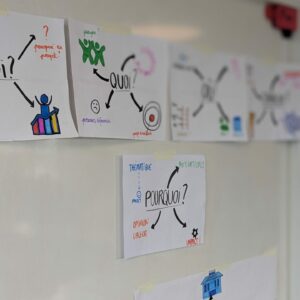
Actualité
05/05/2025
Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Actualité
24/04/2025
Pour contribuer à la communication des projets menés par l’Institut, nous sommes à la recherche d’un·e chargé·e de communication en alternance. Sous la responsabilité du chargé de communication de l’Institut int

Retour sur
07/04/2025
Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.
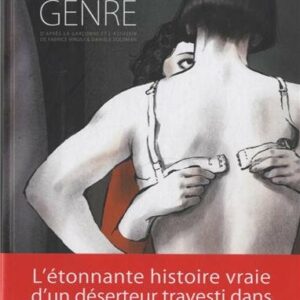
Coup de coeur
28/03/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur
27/03/2025
Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité
24/03/2025
Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité
20/03/2025
Le Prix Liberté vise à mettre en lumière des combats menés pour défendre des libertés dans le monde. Les jeunes, grâce à leur vote, ont le pouvoir de désigner le ou la lauréate du Prix Liberté 2025 qui se verra récompen

Actualité
07/03/2025
Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité
07/03/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité
05/03/2025
Les 23 et 30 avril 2025, l’Institut accueille la Consultation sur les droits de l’enfant dans ses locaux d’Hérouville-Saint-Clair. Une vingtaine de jeunes pourront échanger autour de la thématique du droit des

Coup de coeur
28/02/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Point de vue
25/02/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Actualité
25/02/2025
Le programme pédagogique Ecoality est un projet européen visant à sensibiliser les jeunes normands à l’intersectionnalité des genres et aux changements climatiques. Structuré en trois grandes étapes, ce programme perme

Actualité
21/02/2025
Du 10 au 14 février 2025, le jury international s’est réuni au Dôme et à l’Université de Caen Normandie pour étudier les 601 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois personnes et organisations engagé

Point de vue
12/02/2025
Dans le cadre de la semaine de jury international du Prix Liberté, Fiona Schnell, directrice générale de l’Institut, a donné un cours de droit international aux 23 jeunes réunis. Une prise de parole neutre et ouverte ayant p

Actualité
12/02/2025
Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l

Actualité
07/02/2025
A l’occasion de leur dernier rassemblement, les 18 et 19 janvier derniers, les jeunes du Conseil Régional des Jeunes ont pu découvrir une session de sensibilisation au programme Ecoality

Retour sur
06/02/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix s’est associé à la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) et le Centre LGBTI de Normandie sur la demande de la Protection Judici

Actualité
05/02/2025
Parmi les temps forts du Prix Liberté 2025, le jury international de jeunes âgés de 15 à 25 ans se réunira à Caen, en Normandie, du 10 au 14 février.
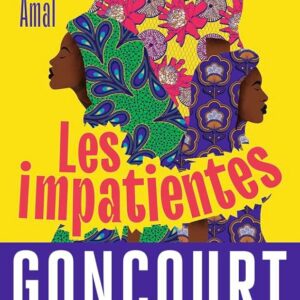
Coup de coeur
27/12/2024
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Point de vue
23/12/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Actualité
18/12/2024
Le concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme est un projet pédagogique qui permet à des jeunes de mettre en lumière et de dénoncer des cas précis de violations des droits de l’Homme à travers le monde. En savoir +

Retour sur
18/12/2024
Du 12 au 14 décembre 2024, Bejaia, en Kabylie, a accueilli la seconde édition du Concours international de plaidoirie, un événement organisé et présidé par le Bâtonnier de l’Ordre régional des avocats de Bejaia, Dr
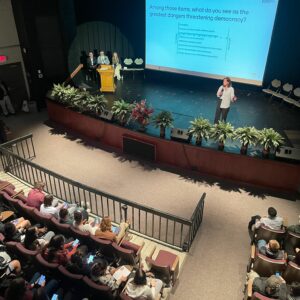
Actualité
16/12/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix forme les professionnels aux droits de l’Homme et aux Objectifs de développement durable pour créer des multiplicateurs, capables à leur tour de sensibiliser et

Point de vue
13/12/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Point de vue
11/12/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Cons. cont., n° 2024-1114 QPC du 29 nov. 2024, Sulliv

Point de vue
04/12/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 202

Point de vue
03/12/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Conseil constitutionnel, n° 2024-1113 QPC du 22 novemb
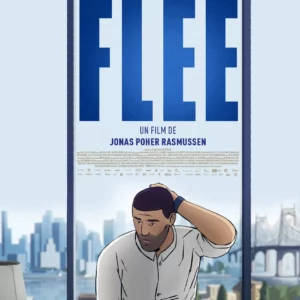
Coup de coeur
02/12/2024
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné pour vous des contenus à regarder, lire et écouter.

Point de vue
02/12/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Conseil d’État, 8 novembre 2024, 487687, publié aux

Retour sur
27/11/2024
Mercredi 20 novembre, l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Rouen, à Saint-Etienne-du-Rouvray, accueillait les septièmes Assises de l’éducation. L’Institut y était invité pour présenter certains de ses proj
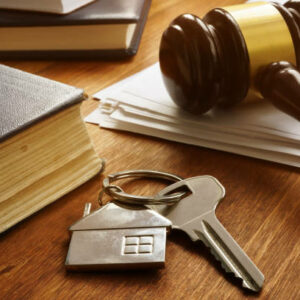
Point de vue
22/11/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Retour sur
21/11/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix co-anime depuis 2022 le Conseil Régional des Jeunes de Normandie aux côtés de la Région Normandie. Dans le cadre d’un weekend de rassemblement à Carolles, ses

Point de vue
21/11/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Point de vue
20/11/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Actualité
20/11/2024
Chaque année, le Défenseur des droits organise son événement de présentation et de valorisation du rapport annuel du Défenseur des droits consacré aux droits de l’enfant basé sur la consultation des enfants. Cette année

Actualité
19/11/2024
La 7ème édition du Prix Liberté est lancée, et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix propose aux enseignants inscrits au programme pédagogique, trois niveaux distincts d’accompagnement pour mettre

Retour sur
23/06/2025
En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.