01/07/2025
Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

par Nathan Bina
Etudiant en Master 2 Droit des libertés
à l’Université de Caen Normandie
Dans le paysage juridique, la laïcité se présente comme une notion complexe et sujette à débats. Elle oscille entre éloges et questionnements, sans que son rôle primordial au sein d’une société démocratique ne soit pour autant remis en question. La complexité de la laïcité réside dans une multitudes d’appréciations, à cheval entre une politique de restriction et un régime de liberté.
La laïcité vise à encadrer l’exercice de la religion, parfois manifestée par le port de signes confessionnels dont l’encadrement ne manquent pas d’agiter les tribunaux européens.
Bien que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) se soit prononcée à plusieurs reprises sur le port de tels signes dans le secteur privé, estimant que l’interdiction du port de signe religieux par un règlement intérieur d’une entreprise privé n’était pas constitutive d’une discrimination directe (G4S Secure Solutions), c’est la première fois qu’elle est confrontée à cette question dans le contexte professionnel au sein de l’administration publique.
Les faits se déroulent en Belgique, à Ans. En 2021, la commune interdit à l’une de ses employées de porter le foulard islamique. Par la suite, la commune a modifié son règlement interne pour étendre cette interdiction à l’ensemble du personnel, prohibant ainsi le port de tout signes religieux. L’employée, estimant cette mesure discriminatoire et invoquant la violation de sa liberté de religion sur le fondement de l’article 8 de la loi belge de 2007 tendant à la lutte contre certaines formes de discrimination (ci-après : Loi Belge) a saisi les juridictions nationales.
Le tribunal de Liège, confronté à cette affaire, s’interroge sur la conformité du règlement adopté par la commune avec le droit de l’Union et la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 instaurant un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci-après : directive de 2000). Le Tribunal de Liège suspend sa décision et transmet l’affaire à la CJUE sous la forme de questions préjudicielles.
Deux questions sont soumises aux juges européens dans cette affaire. La première question porte sur l’interprétation de la directive, aux fins de savoir si cette dernière peut être interprétée comme autorisant une administration publique, sous réserve d’organiser un environnement de travail neutre, à interdire tout signe religieux.
Pour déterminer sous quelles conditions une mesure interdisant le port de signes religieux au travail peut être légitime, la CJUE développe un argumentaire qu’elle a su étayer au gré de ses jurisprudences.
Premièrement, une mesure d’interdiction des signes convictionnels par un employeur ne constitue pas une discrimination directe, pour autant que tous les signes, sans exception aucune, soient concernés (CJUE, 13 oct. 2022, L.F. c. S.C.R.L., C-144/20). Deuxièmement, la règle en question doit être appliquée de manière générale et indifférencié. Cette exigence peut toutefois être écarté si elle sert un objectif légitime (CJUE, 15 juillet 2021, WABE et MH Müller Handel, C-804/18 et C-341/19), dans notre cas d’espèce: la neutralité du service public.
La CJUE rappelle ce qu’elle avait dégagée dans l’arrêt précité L.F. c. S.C.R.L (2022) : les mesures mises en place pour atteindre l’objectif fixé par l’administration doivent se limiter au strict nécessaire (Pt. 37).
L’affaire Commune d’Ans est novatrice en ce qu’elle permet à la CJUE, pour la première fois, d’appliquer son raisonnement à une administration publique. En effet, bien que les juges européens n’aient pas explicitement consacré la volonté d’appliquer une neutralité stricte dans l’arrêt L.F. c. S.C.R.L. (2022), le présent arrêt suggère que la recherche d’une neutralité stricte est considéré comme plus justifié pour un employeur public que privé. Cependant, l’employeur doit démontrer cette légitimité.
La CJUE n’entend toutefois pas définir l’exercice du principe de neutralité dans les administrations publiques. En effet, dans le cadre du renvoi préjudiciel, la Cour laisse aux États le soin de juger de la légalité et de l’opportunité de telles mesures: «Chaque État membre, et toute entité infra-étatique dans le cadre de ses compétences, dispose d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’ils entendent promouvoir sur le lieu de travail, en fonction du contexte propre qui est le leur » (Pt. 33).
Dans ce cadre, et en opérant un raisonnement a contrario, selon le contexte et le cadre propre à chaque entité administrative, une administration publique, pourrait autoriser : «de manière générale et indifférenciée, le port de signes visibles de convictions, notamment, philosophiques ou religieuses, y compris dans les contacts avec les usagers, ou une interdiction du port de tels signes limitée aux situations impliquant de tels contacts » (Pt. 33)
La seconde question soulevée par la juridiction de renvoi concerne la potentielle qualification de discrimination indirecte fondée sur le genre, le foulard islamique étant principalement porté par les femmes musulmanes. La CJUE écartera cette question, cette dernière se basant sur la directive 2006/54 du 5 juillet 2006 sur l’égalité des chances et non sur la directive de 2000 en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
De surcroît, la CJUE considère cette question dépourvue d’éléments rattachables au litige en question. En effet, la décision de renvoi ne précise pas les faits sur lesquelles cette question repose, ni même les raisons pour lesquelles une réponse à cette question serait nécessaire au litige en l’espèce (Pt. 49).
Cet arrêt marque une étape importante dans le traitement de la laïcité par les juridictions européennes. En effet, c’est la première fois que la CJUE se penche sur le port de signes à religieux pour le personnel du service public.
Cette décision de la Cour, même si novatrice, nécessite d’être tempérée. Elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE, qui estime qu’une clause d’un règlement intérieur interdisant le port de signe religieux n’est pas constitutive d’une discrimination directe, sous réserve de la stricte nécessité de cette proscription.
Si cette décision pourrait avoir un impact non négligeable au niveau européen en matière de laïcité, elle ne devrait pas impacter le système français. En effet, la vision française de la neutralité impose à tout agent du service public, qu’il soit en contact ou non avec les usagers, à la stricte politique de neutralité, excluant tout signe confessionnel visible (Articles L.121-2; L.121.4 du code général de la fonction publique, en ce qui concerne les agents publics ; article 1 L.24 août 2021, pour ce qui est des salariés privés d’un service public).
Toujours est-il qu’une modification des législations au-delà des frontières de l’hexagone est possible, certains de nos États voisins comme la Suède autorisant le port du voile dans l’enseignement public, (Cour administrative suprême suédoise, 8 décembre 2022). D’autres États comme l’Espagne ou l’Italie, en proie à de nombreux débats sur le port du voile, pourraient être tentés de franchir le pas vers une législation plus stricte.
Même si cette décision entend étoffer la jurisprudence de la CJUE, elle ne fait que fixer un cadre global sur le port de signes religieux au travail. En définitive, la CJUE, par une décision de principe, permet à chaque État membre, au nom du respect d’un contexte national et de traditions propres, de juger de l’opportunité de telles mesures.
Sans bouleverser l’ordonnancement juridique, cette décision pourrait favoriser l’émergence d’une «laïcité à la française» au sein de l’Union Européenne. L’influence que cet arrêt pourrait exercer au-delà des frontières françaises demeure incertaine, et seul le temps dévoilera l’étendue de son retentissement à l’échelle européenne.

Actualité
01/07/2025
Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur
23/06/2025
En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité
17/06/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur
16/06/2025
Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent
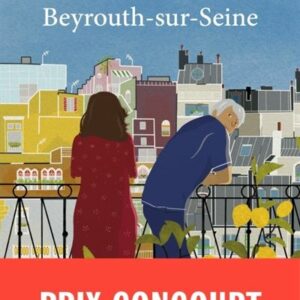
Coup de coeur
30/05/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur
28/05/2025
Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité
14/05/2025
Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité
07/05/2025
Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et
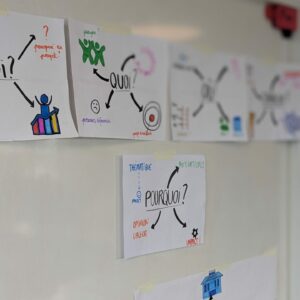
Actualité
05/05/2025
Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur
07/04/2025
Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.
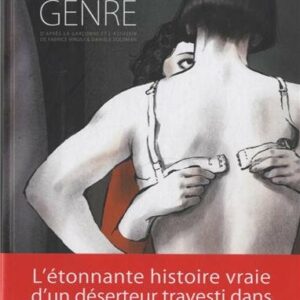
Coup de coeur
28/03/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur
27/03/2025
Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité
24/03/2025
Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité
07/03/2025
Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité
07/03/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité
12/02/2025
Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l