03/07/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et le Master Droit des libertés de l’UFR Droit de l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.
par Zoé CASPAR
Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit
de l’Université de Caen Normandie
Affaire : Conseil constitutionnel, déc. n°2021-932, 23 sept, 2021
Le législateur, dans un souci de lutter contre les profits tirés d’une infraction, a multiplié les lois afin de pouvoir saisir et confisquer les profits illicites, notamment les lois n°2013-1117 du 6 décembre 2013 ; n°2009-1437 du 24 novembre 2009 et la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013.
L’article 131-21 du Code Pénal prévoit que “tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction” peuvent faire l’objet d’une confiscation. Cette peine complémentaire s’applique également aux biens dont le condamné a la libre disposition,“sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.”. Cette peine est notamment prévue pour les délits d’escroquerie (C. Pénal, art. 313-7 4°) et de blanchiment (C. Pénal, art. 324-7 8°).
En étendant le champ de cette peine complémentaire, la loi n’a pas pour autant prévu des garanties pour le propriétaire de bonne foi du bien objet de la confiscation.
C’est cette lacune qui donne lieu à une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) renvoyée par la Cour de Cassation (Cass, crim., 16 juin 2021 n°20-87.060) au Conseil Constitutionnel (ci-après C.Constit.).
Les requérantes (les sociétés tierces propriétaires) dénoncent la méconnaissance dans les articles litigieux du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégés par l’article 16 de la Déclaration de 1789. En soulevant l’incompétence négative du législateur, elles dénoncent les vides juridiques relatifs à la violation du droit de propriété et l’absence de recours contre la confiscation de leurs biens. La loi permet en effet au juge de prononcer la confiscation sans permettre au tiers propriétaire des biens de comparaître ou présenter des recours contre la décision.
Le C.Constit constate qu’aucune disposition ne prévoit “que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. “ (§ 15). La faculté de confisquer un bien dont le condamné a seulement la libre disposition est donc déclarée inconstitutionnelle .
Pour éviter des conséquences manifestement excessives de sa décision, le C.Constit diffère l’abrogation des articles en cause au 31 mars 2022, non applicable au litige en cours ici.
Afin de contrecarrer l’utilisation de cette technique, les requérants demandaient un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE), estimant que l’effet différé de la décision prononçant l’inconstitutionnalité porterait atteinte au droit de l’Union Européenne. Cet argument est écarté aux motifs qu’il n’entre pas dans les attributions du C. constit. “d’examiner la compatibilité des dispositions déclarées contraires à la Constitution avec les traités ou le droit de l’Union européenne” (§18) et que la question ne porte pas sur la validité ou l’interprétation d’un acte pris par les institutions de l’Union Européenne.
A compter du 31 mars 2022, le juge pénal ne pourra plus confisquer un bien dont le condamné n’a que la libre disposition, sauf si, avant cette date, la loi a prévu des garanties au profit du propriétaire de bonne foi dudit bien, lui permettant d’être mis en mesure de se défendre.
Cette décision était prévisible, car la question avait déjà été posée pour d’autres infractions. Dans une affaire de proxénétisme aggravé, au titre de peine complémentaire, plusieurs membres d’une famille s’étaient vu confisquer des biens dont ils n’avaient que la libre disposition. Une QPC fut présentée, soulevant l’inconstitutionnalité de cette peine car les tiers propriétaires de bonne foi n’étaient pas convoqués ni avisés de la procédure. Dans sa décision QPC 2021-899 du 23 avril 2021 le C.Constit avait déclaré contraires à la Constitution les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » de l’article 225-25 du code pénal.
Aucune disposition de la Constitution ne garantit explicitement les droits de la défense mais l’évidence constitutionnelle du respect de ceux-ci a été institutionnalisée en les rattachant à la “garantie des droits” protégée par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
M. Jean-Louis DEBRE dans son discours du 4 décembre 2009 rappelle-lui même le lien indispensable entretenu alors entre la QPC en devenir, et le respect des droits de la défense « avec la question prioritaire de constitutionnalité il y aura un véritable procès de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel et une véritable audience publique. Cela correspond à une exigence qui a des fondements constitutionnels dans l’article 16 de la Déclaration de 1789. Elle répond également aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme”.
Cette déclaration rappelle que les droits de la défense sont une tradition française respectée depuis toujours par le C.Constit. Cette prise de position constante du respect du principe du contradictoire n’apparaît pas étonnante.
Toutefois le caractère inébranlable de cette protection des droits de la défense semble à nuancer.
Les neuf Sages font le choix de moduler dans le temps, les effets de cette décision.
L’effet différé est souvent utilisé par le C.Constit, et cela même avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (Décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008). Cela permet d’éviter les conséquences manifestement excessives d’une abrogation directe et non préparée, d’une disposition. Dans sa décision Chessa c. France 76186/11, la Cour Européenne des Droits de l’Homme précise ses décisions antérieures en acceptant ce report temporel s’il est justifié et non arbitraire.
Cependant, la doctrine demeure énormément critique à ce sujet. Déclarer une disposition inconstitutionnelle, en la laissant dans l’ordonnancement juridique pendant un temps défini, semble déjà perturbant ; mais reconnaître l’inconstitutionnalité de la disposition, ignorant de ce fait l’article 16, sans l’appliquer à la situation du requérant apparaît éminemment discutable.
La technique de l’effet différé appliquée à cette décision inconstitutionnelle semble heurter certains principes de l’Etat de droit et de la sécurité juridique. Cela crée une situation paradoxale afin d’éviter un vide juridique et permettre au législateur de corriger les dispositions inconstitutionnelles.
En incluant la CJUE à la QPC, dans l’hypothèse où la Cour déclare contraires au droit de l’Union Européenne les dispositions litigieuses, les requérants ont voulu dénoncer cette pratique de moduler dans le temps le respect des droits de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
En réaffirmant que seules les juridictions administratives et judiciaires peuvent réaliser un contrôle de conventionnalité des dispositions déclarées contraires à la Constitution (d’après sa décision n°74-54 DC) ; il semble avoir trouvé une réponse efficace en déclarant l’incompétence d’attribution de la CJUE, lui permettant ainsi de réaffirmer sa supériorité juridique dans le système français.
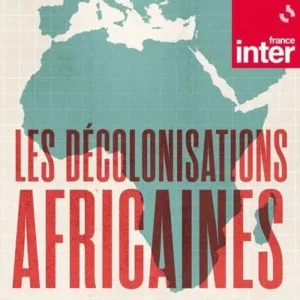
Coup de coeur
03/07/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité
01/07/2025
Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur
23/06/2025
En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité
17/06/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur
16/06/2025
Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent
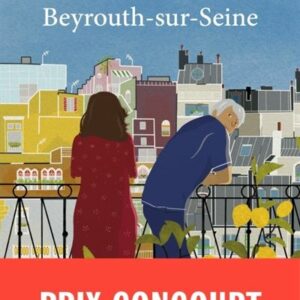
Coup de coeur
30/05/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur
28/05/2025
Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité
14/05/2025
Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité
07/05/2025
Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et
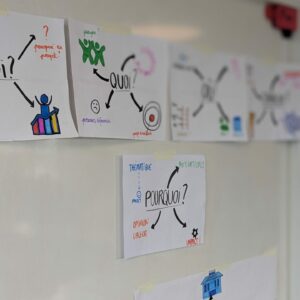
Actualité
05/05/2025
Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur
07/04/2025
Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.
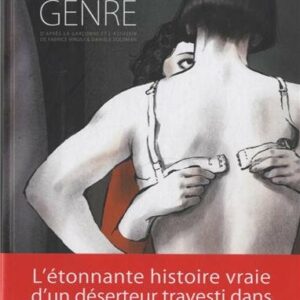
Coup de coeur
28/03/2025
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur
27/03/2025
Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité
24/03/2025
Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité
07/03/2025
Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité
07/03/2025
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité
12/02/2025
Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l