11/04/2024
« ecHo », le podcast de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et de Radio Phénix sur les changements climatiques.
Par Catherine-Amélie Chassin
Professeur de droit public, Institut caennais de recherche juridique (ICREJ), Université de Caen Normandie
Secrétaire général de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix

Affaire : Cour EDH, GC, 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France, 24384/19 et 44234/20
Texte : Convention européenne des droits de l’Homme
Quelles sont les obligations de la France vis-à-vis des enfants français de djihadistes partis combattre pour Daesh, telle est la question posée par l’affaire H.F. et autre c. France. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) le 14 septembre 2022 ne clôt pas totalement le débat, mais il pose des contours clairs sur un certain nombre d’éléments.
Ces enfants, souvent retenus avec leurs mères dans des camps gérés par les forces démocratiques de Syrie (forces kurdes d’opposition au régime de Bachar Al-Assad), ont fait l’objet de demandes récurrentes de rapatriement. Dans la présente affaire, la Cour EDH a été saisie de deux requêtes jointes : d’une part une femme et ses deux enfants nés en Syrie, qui tous trois se trouveraient dans le camp de Al-Hol (aff. 24384/19), d’autre part une femme et son enfant né en Syrie, qui se trouveraient ensemble dans le camp de Roj (aff. 44234/20). Ces demandes ont été présentées parfois par les mères parties volontairement à travers leurs conseils juridiques (aff. 44234/20), parfois par les grands-parents demeurés en France au nom de leur fille et de leurs petits-enfants (aff. 24384/19). Ces demandes n’ont pas toutes abouti. En juillet 2022, un Communiqué du Ministère des affaires étrangères annonçait le retour de 35 enfants français retenus dans les camps – et plusieurs mères, qui ont immédiatement été remises aux autorités judiciaires compétentes. Pourtant des enfants demeurent dans ces camps, ce que d’ailleurs reconnaît ce même Communiqué.
Le Conseil d’Etat français a considéré que la décision d’organiser ou non le rapatriement était un acte de gouvernement non détachable de la conduite des relations internationales de la France et, partant, n’était pas justiciable devant les juridictions internes (Voir CE, Ord., 23 avril 2019, n° 429669 ; aussi CE, 9 septembre 2020, n° 439520). Le juge interne se refuse donc à tout contrôle sur la décision d’organiser ou non le rapatriement des intéressés. Le Comité des droits de l’enfant, instance internationale non juridictionnelle, avait pour sa part conclu à la violation de ses obligations par la France (CRC, 8 février 2022, n° 77/2019, 79/2019 et 109/2019), mais il avait occulté la question centrale : ces enfants sont-ils sous la juridiction de la France ? Cette difficulté majeure est au cœur de l’arrêt rendu par la Cour EDH. L’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH) réserve en effet la compétence de la Cour – et la responsabilité des Etats sur le fondement de ce texte – aux personnes se trouvant sous la juridiction de l’Etat, et seulement à ces personnes. De ce point de vue, la Cour EDH donne par le présent arrêt une magistrale leçon sur ce qu’est la notion de juridiction, rappelant que « la juridiction au sens de l’article 1 est une condition sine qua non. Elle doit avoir été exercée pour qu’un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui imputables » (§ 184).
La Cour EDH commence par rappeler que la France ne contrôle pas le territoire syrien, et en conséquence elle ne saurait engager pas sa responsabilité sur ce fondement (§ 192). Sa jurisprudence désormais classique sur le contrôle d’un territoire (Voir p.ex. Cour EDH, GC, 23 février 1995, Loizidou c. Turquie, n° 15318/89, pour des faits en République turque de Chypre du Nord) n’est donc pas applicable aux faits de l’espèce.
Elle estime en outre que l’ouverture de procédures pénales contre les mères n’est pas suffisante pour créer ce lien (§ 195), car le contraire reviendrait à dissuader les Etats de poursuivre les faits de terrorisme commis à l’étranger. Certes l’ouverture d’une procédure juridictionnelle peut dans certains cas créer un lien avec l’Etat (en ce sens, Voir Cour EDH, GC, 14 décembre 2006, Markovic c. Italie, 1398/08, § 54 al. 2). Néanmoins la Cour a déjà considéré dans une précédente affaire que « si le simple fait d’ouvrir au niveau national une enquête pénale sur n’importe quel décès survenu n’importe où dans le monde suffisait à faire naître un lien juridictionnel sans qu’aucune autre condition ne soit requise, le champ d’application de la Convention s’en trouverait élargi dans une mesure excessive » (Voir Cour EDH, 16 février 2021, Hanan c. Allemagne, 4871/16, § 135). Dans l’arrêt de 2021, elle avait admis le lien car par application de l’Accord germano-afghan, seule l’Allemagne était compétente pour juger des allégations de crimes de guerre commis par ses troupes en Afghanistan (Voir § 137 de l’arrêt Hanan c. Allemagne). S’agissant des enfants de djihadistes, la Cour estime que les actions pénales introduites en France ne sont pas un fondement suffisant.
Dans la présente affaire, la Cour rejette également l’argument selon lequel la nationalité suffirait à créer ce lien (§ 198), l’article 1er de la Convention EDH s’attachant à la notion de « juridiction de l’Etat », et non à la notion de nationalité. En conséquence, il n’est pas possible de retenir de violation sur le fondement de l’un des droits de la Convention, faute de lien de rattachement suffisant avec la France : la nationalité des mères et des enfants ne saurait être un argument pertinent ici. La Cour rappelle que « ni le droit interne ni le droit international […] n’impose à l’Etat d’agir en faveur de ses ressortissants et de les rapatrier » (§ 201). L’extension du champ d’application à un critère fondé sur la nationalité ne trouve, selon les mots de la Cour, « aucun appui dans la jurisprudence » (§ 203).
En conséquence, la Cour ne saurait donc examiner les griefs allégués par les requérants, fondés sur l’existence de traitements inhumains et dégradants dans les camps (art. 3 CEDH) ou sur la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). De ce point de vue, c’est bien une irrecevabilité qui est opposée aux demandes.
Pour autant poursuit la Cour, l’analyse doit être différente s’agissant du droit de rentrer dans son propre pays, droit fondé sur l’article 3 § 2 du Protocole IV. Si la nationalité ne saurait à elle seule fonder un titre de compétence de la Cour (§ 205), « limiter l’invocabilité du droit d’entrer […] aux ressortissants se trouvant déjà sur le territoire […] reviendrait à le rendre inopérant » (§ 209). Dès lors, la Cour européenne admet que « certaines circonstances tenant à la situation de la personne qui prétend entrer […] puissent faire naître un lien juridictionnel » (§ 212). Dans les circonstances de l’espèce, elle retient ce lien entre les personnes visées et la France compte tenu notamment de l’extrême vulnérabilité des enfants ou de leur impossibilité matérielle de quitter les camps sans intervention de l’Etat (§ 213).
Pour autant, la Cour EDH rappelle que la France n’a pas d’obligation générale de rapatriement : le Protocole IV garantit un droit d’entrer, mais ne garantit pas un droit à rapatriement, ce qui supposerait une obligation positive de l’Etat. Or l’article 3 § 2 du Protocole IV crée une obligation négative, celle de ne pas opposer d’obstacles au retour en France. Dans l’hypothèse du retour des enfants de Djihadistes, la Cour confirme cette approche, rappelant que les obligations positives sont a priori limitées à la délivrance des documents d’identité et de voyage en vue du retour (§ 251). Elle en déduit que « aucune obligation de droit international conventionnel ou coutumier ne contraint les Etats à rapatrier leurs ressortissants » et que « les citoyens français retenus dans les camps du Nord-Est de la Syrie ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice d’un droit général au rapatriement au titre du droit d’entrer sur le territoire national » (§ 259).
Pour autant, la Cour ne s’arrête pas à ce stade : elle rappelle sa jurisprudence classique selon laquelle « la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (Voir ici le principe posé par l’arrêt Cour EDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, 6289/73). En conséquence, le principe général posé par le Protocole IV peut faire naître des obligations positives particulières, en fonction d’un contexte propre (§ 260). Certes ajoute-t-elle, cette possibilité reste d’interprétation étroite et n’obligera les Etats qu’en présence de circonstances exceptionnelles, mais tel est le cas lorsque « des éléments extraterritoriaux menacent directement l’intégrité physique et la vie d’un enfant placé dans une situation de grande vulnérabilité » (§ 261), ce qui est indéniablement la situation des enfants se trouvant dans les camps syriens.
Le contrôle de la Cour se limite alors à la lutte contre tout arbitraire dans les décisions, ces mesures devant être soumises à « une forme de procédure contradictoire devant un organe indépendant » (§ 275). Or indéniablement, le Conseil d’Etat se retranchant derrière l’acte de gouvernement, les procédures ouvertes ne sont pas adaptées. La Cour EDH en déduit que « les garanties dont ont bénéficié les requérants n’étaient pas appropriées » (§ 278), faute de réponse directe et claire du Président de la République et du Ministère des affaires étrangères, faute également d’intervention effective des juridictions internes. La Cour en déduit que la France a manqué à ses obligations s’agissant de l’accès à un organe indépendant de contrôle des nationaux souhaitant revenir sur le territoire de l’Etat. C’est sur cet unique volet de l’article 3 § 2 Prot. IV que la Cour retient la responsabilité de la France. Dans la lignée de sa démonstration, elle estime que le simple constat de la violation constitue une satisfaction suffisante (§ 288), et ne prévoit que le remboursement des frais de procédure et assimilés.
L’arrêt de la Cour EDH a déjà été largement commenté par la doctrine, les ONG et les acteurs du dossier. Tous les commentateurs n’ont pas nécessairement saisi tout à la fois l’importance et la mesure de l’arrêt. La Grande Chambre écarte la théorie de l’acte de gouvernement dans le cadre des demandes de rapatriement, cassant ainsi la jurisprudence du Conseil d’Etat. De ce point de vue, c’est effectivement une leçon qui est donnée : « les concepts de légalité et d’Etat de droit dans une société démocratique requièrent que les mesures qui affectent les droits fondamentaux doivent être soumises à une forme de procédure contradictoire devant un organe indépendant » (§ 275). Certes ajoute-t-elle aussitôt, cet organe n’est pas nécessairement juridictionnel. Pour autant, cet organe doit « permettre d’évaluer les éléments factuels et autres qui ont amené ces autorités à décider qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande en question. L’organe indépendant saisi doit ainsi pouvoir contrôler la légalité d’une décision rejetant une telle demande, soit que les autorités compétentes aient refusé d’y faire droit, soit qu’elles se soient efforcées d’y donner suite mais sans résultat. Un tel contrôle devrait permettre aussi au requérant de prendre connaissance, même sommairement, des motifs de la décision et ainsi de vérifier que ceux-ci reposent sur une base factuelle suffisante et raisonnable » (§ 276). Et de conclure, on ne peut plus clairement : « En somme, il doit exister un mécanisme de contrôle des décisions ne donnant pas suite aux demandes de retour sur le territoire national qui permet de vérifier que les motifs tirés de considérations impérieuses d’intérêt public ou de difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel que les autorités exécutives pourraient légitimement invoquer sont bien dépourvus d’arbitraire » (§ 276, dernière phrase). Dans le cadre des affaires entourant le rapatriement des enfants de djihadistes, c’est là un apport essentiel au droit français.
Pour autant, l’apport de l’arrêt s’arrête là. S’il offre une leçon magistrale sur l’interprétation de l’article 1er de la Convention, il rappelle que le concept de « juridiction » est avant tout territorial et qu’il n’inclut pas en principe le lien de nationalité. La Cour refuse donc de statuer sur les mauvais traitements perpétrés dans les camps en Syrie, pas davantage qu’elle ne statue sur l’atteinte à la vie privée et familiale, faute d’avoir un lien de rattachement suffisant avec la France. La France annonce certes qu’elle renouvellera « ce type d’opérations de rapatriement sera envisagé chaque fois que les conditions le permettront, en considération de l’évolution de la situation sur zone et au regard notamment des conditions de sécurité entourant la détention des ressortissants français retenus dans les camps du nord-est syrien » (Point de presse du Ministère des affaires étrangères en date du 14 septembre 2022). Néanmoins l’arrêt de la Cour EDH ne lui impose pas d’organiser ces opérations. Il se contente, apport essentiel et pourtant finalement limité, de prévoir un droit de recours afin de lutter contre tout arbitraire dans ces décisions.

Actualité
11/04/2024
« ecHo », le podcast de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et de Radio Phénix sur les changements climatiques.
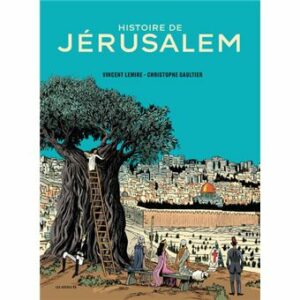
Coup de coeur
28/03/2024
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter pour mieux comprendre les combats des trois nommés du Prix Liberté 2024.

Actualité
25/03/2024
L’Institut recrute un.e chargé.e de mission pédagogique…Découvrir l’offre.

Actualité
20/03/2024
Le Prix Liberté vise à mettre en lumière des combats menés pour défendre des libertés dans le monde. Les jeunes, grâce à leur vote, ont le pouvoir de désigner le ou la lauréate du Prix Liberté 2024.

Actualité
12/03/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et le lycée Français de Nouakchott organisent le 7e Concours d’éloquence de la jeunesse mauritanienne pour les droits de l’Homme le 22 mai à Nouakchott.

Actualité
01/03/2024
L’Institut, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 13e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina.

Retour sur
21/02/2024
Du 12 au 16 février, l’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a organisé et animé les délibérations du jury international du Prix Liberté 2024.

Actualité
12/03/2024
L’Institut organise, avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et l’association Yes Tafita, une formation à l’éducation aux droits de l’Homme.

Coup de coeur
01/03/2024
L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter en faveur de la Journée international des droits des femmes du 8 mars.

Actualité
23/02/2024
L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute un.e chargé.e de communication.